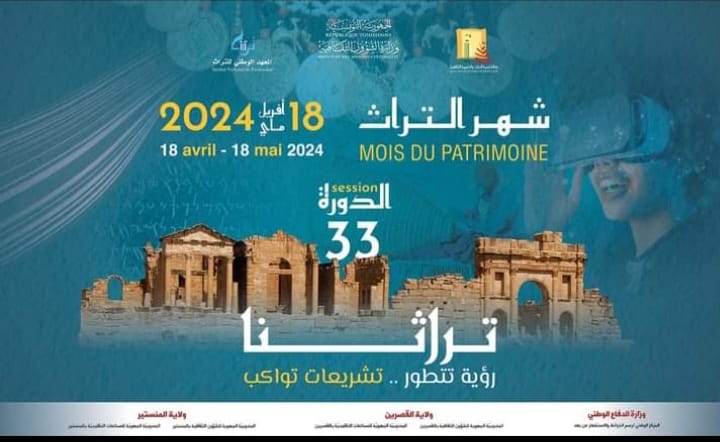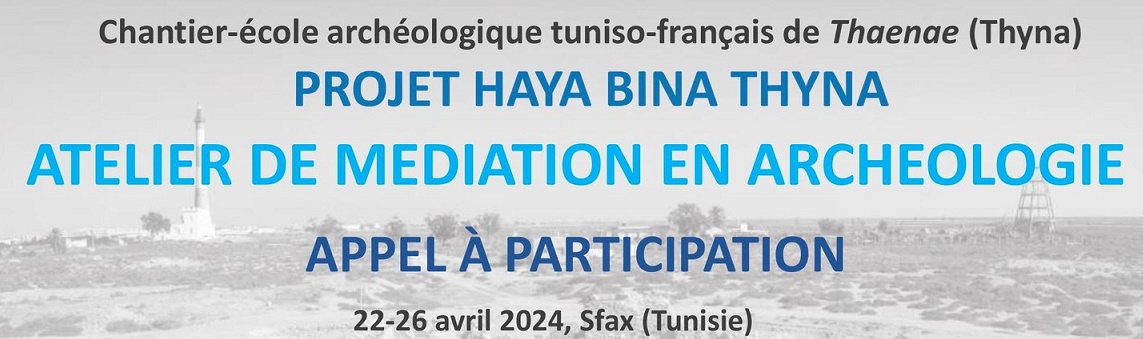Activités Scientifiques الحفريات ، الملتقيات العلمية، الندوات والاستكشافات الاثرية

Sites archéologiques, المواقع الأثرية , Archaeological sites
Utique est l'une des premières villes phéniciennes de l'Afrique du Nord. Elle a été fondée selon Pline l'Ancien, Pseudo-Aristote et Velleius Paterculus en 1101 avant J.-C.,